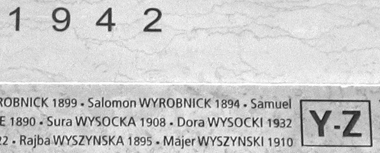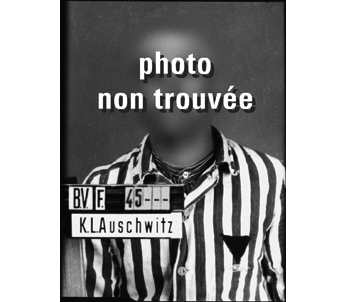
Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz
lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.
Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.
Mayer Wyszynski naît le 1er mars 1910 à Varsovie (Pologne), fils de Lajbus Wyszynski et de Pesa Kerszenblat, son épouse, commerçants.
À partir de 1935 et jusqu’au moment de son arrestation, Mayer Wyszynski est domicilié au 31 quai d’Anjou à Paris 4e (75). Il est chapelier. Il a conservé la nationalité polonaise.
Le 31 octobre 1940, à Paris 4e, il se marie avec Bejla Lew, né en 1909 à Sokolw (Pologne), qui habite à la même adresse.
Mayer Wyszynski est père de deux filles : Marie, née le 6 avril 1937, et Liliane, née le 6 janvier 1941, toute deux à Paris.
Le 13 mai 1941, il est reçoit une convocation – le “billet vert” [1] – pour « vérification » de ses papiers, comme Chaïm Blumenfeld de Paris 17e. Le lendemain, il est arrêté sur place, puis interné au camp de Beaune-la-Rolande (Loiret) où il est enregistré sous le matricule 1984. Transféré ensuite au camp de Drancy [2] (Seine / Seine-Saint-Denis ), il s’en évade le 11 août 1941.
Le 11 novembre, il se présente à la préfecture de police pour faire prolonger sa carte d’identité. Aussitôt arrêté, il est conduit au Dépôt. Deux jours plus tard, le 13 novembre, la 12e chambre du tribunal correctionnel de la Seine le condamne à six semaines d’emprisonnement pour évasion.
Le 24 décembre, à l’expiration de sa peine, il est de nouveau interné à Drancy. Le 27 janvier 1942, il est transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 –Polizeihaftlager). En avril, malade, il est provisoirement transféré à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, mais doit réintégrer le camp de Royallieu le 4 juillet.
Entre fin avril et fin juin 1942, il a été sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler) ; Mayer Wyszynski a été sélectionné comme otage juif.
Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.
Le voyage dure deux jours. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.
Le 8 juillet 1942, Mayer Wyszynski est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 46315, selon les listes reconstituées (aucune photo de détenu de ce convoi n’a été retrouvée après le matricule 46172).
On ignore la date exacte de sa mort à Auschwitz ; probablement avant la mi-mars 1943.
Le 29 février 1952, le tribunal civil de la Seine rend un jugement déclaratif de décès, fixant pour l’état civil la date de celui-ci au « 6 juillet 1942 à Compiègne », bien que le fait soit déjà établi que Mayer Wyszynski était dans le convoi parti ce jour-là à destination d’Auschwitz.
Le 21 janvier 1952, sa veuve remplit un formulaire de demande d’attribution du titre de déporté politique à titre posthume ; la carte n° 1175 01593, lui est attribuée le 5 mars 1954. Elle habite alors à Argenteuil (Seine-et-Oise / Val-d’Oise).
- Sur le Mur des noms du Mémorial de la Shoah,
au 17 rue Geoffroy-l’Asnier à Paris 4e,
parmi les déportés de l’année 1942.
Sources :
Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 371 et 423 ; notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002).
Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, Caen ; dossier de Mayer Wyszynski (21 P 551 395).
MÉMOIRE VIVE
(dernière mise à jour, le 31-05-2016)
Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).
En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.