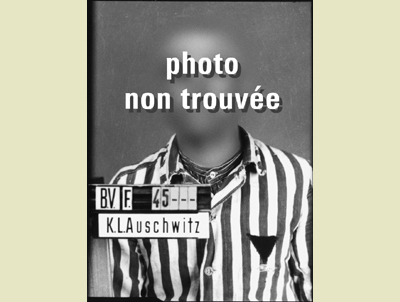Omer, Félix, Proust naît le 1er avril 1903 à Dampierre-sur-Brou (Eure-et-Loir – 28), chez ses parents, Emile Proust, 32 ans, maçon, et Marie Félicité Lesèque, 25 ans, son épouse, domiciliés au hameau du Chemin en cette commune. Les témoins pour la présentation du nouveau-né à l’état civil sont un sabotier et un ouvrier sabotier.
Le 29 septembre 1930, Omer Proust épouse Georgette Hallier à Rambouillet [1] (Yvelines – 78) où ils emménagent. Ils ont dix enfants : Yvonne (1930), Huguette (1931), Guy (1933), Denise (1934), Claude (1935), Bernard (1936), Claudine (1937) et Daniel (1940), nés à Rambouillet ; les deux dernières, Simone (1941) et Christiane (1942), naissent à Ivry-sur-Seine [2] (Val-de-Marne – 94).
C’est donc entre 1940 et 1941 que la famille vient habiter au 123, route stratégique (devenu le 134 rue Marcel-Hartmann).
Omer Proust est alors maçon et contremaître de chantier à la régie municipale d’Ivry, mais sans être employé communal (fonctionnaire territorial).
Il est connu comme militant communiste.
Le 28 avril 1942, il est arrêté lors d’une grande vague d’arrestations (397 personnes) organisée par « les autorités d’occupation » dans le département de la Seine – avec le concours de la police française – et visant majoritairement des militants du Parti communiste. Ces arrestations visant généralement des personnes précédemment arrêtées par la police française puis relâchées, il est possible qu’ait existé, à l’encontre d’Omer Proust, une poursuite antérieure que nous ignorons. Les hommes arrêtés sont rapidement conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise – 60), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).
Entre fin avril et fin juin, malgré sa nombreuse famille, Omer Proust est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée (suivant un ordre de Hitler) en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée d’occupation.
Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.
Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.
Le 8 juillet, Omer Proust est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 46019, selon les listes reconstituées (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).
- Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz.
Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.
Après l’enregistrement, les 1170 arrivants sont entassés dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.
Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau où ils sont répartis dans les Blocks 19 et 20.
Le 10 juillet, après l’appel général et un bref interrogatoire, ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos.
Le 13 juillet – après cinq jours passés par l’ensemble des “45000” à Birkenau – la moitié des membres du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I) après l’appel du soir. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a été affecté Omer Proust.
Il meurt à Auschwitz le 19 septembre 1942, selon les registres du camp [3], alors qu’a lieu une grande sélection des “inaptes au travail” à l’intérieur du camp au cours de laquelle 146 des “45000” sont inscrits sur le registre des décès en deux jours (probablement gazés [4]). (aucun des quatorze “45000” ivryens n’est revenu).
La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 18-04-1998).
Sources :
Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, dossier individuel rassemblé par Michèle Rault, conservatrice, à partir de différentes sources.
Archives départementales d’Eure-et-Loir, site internet, archives en ligne, registre d’état civil de Dampierre-sous-Brou, années 1902/1906 (cote 3 E 123/013), naissances de l’année 1903, acte n° 3 (vue 40/157).
Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection Mémoires, 2005, pages 82, 150 et 153, 388 et 418.
Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 968 (31856/1942).
MÉMOIRE VIVE
(dernière mise à jour, le 6-09-2015)
Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).
En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes) qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.